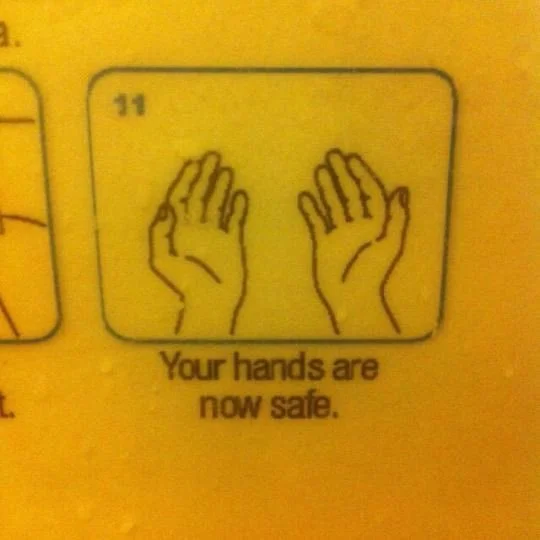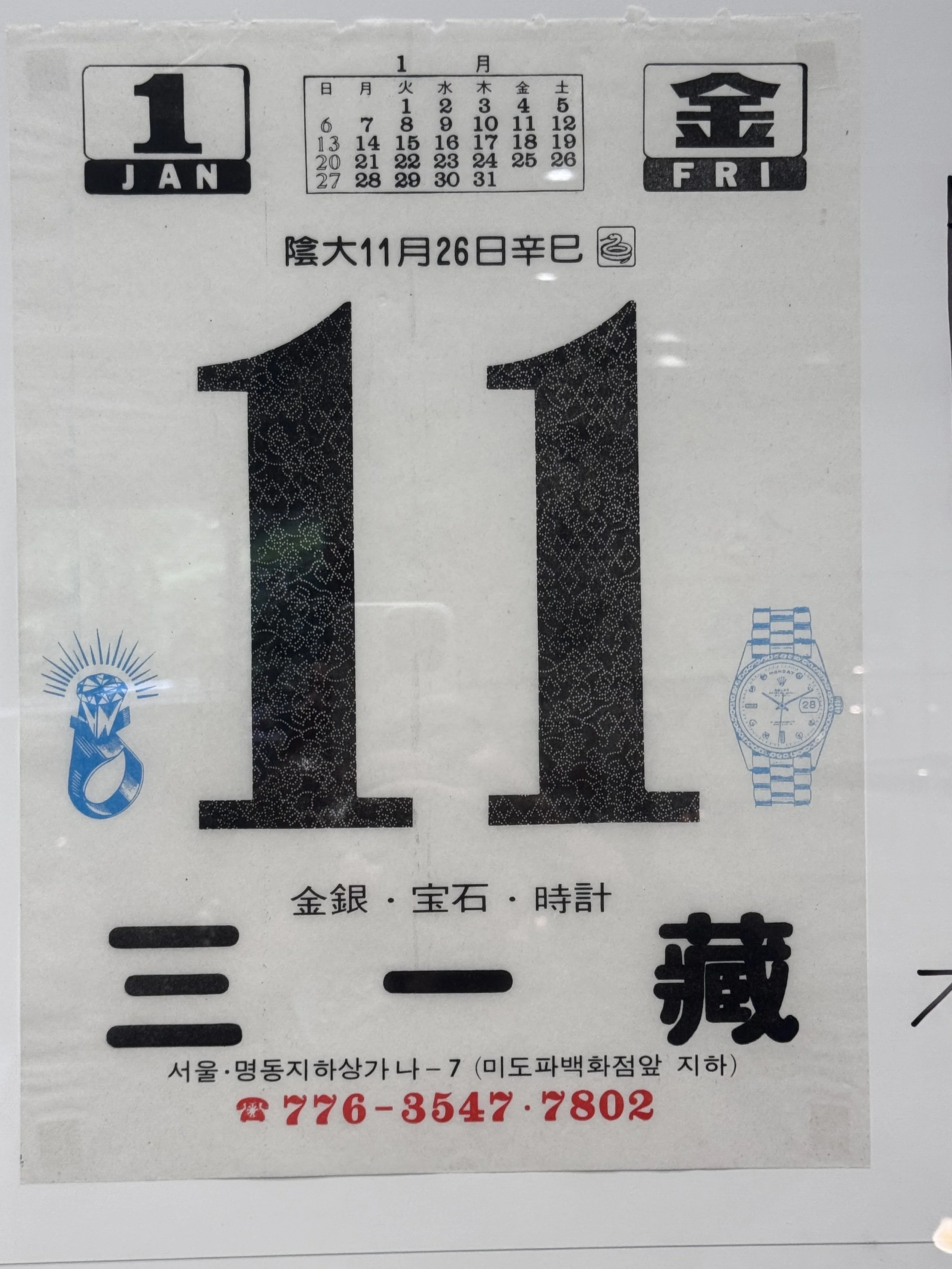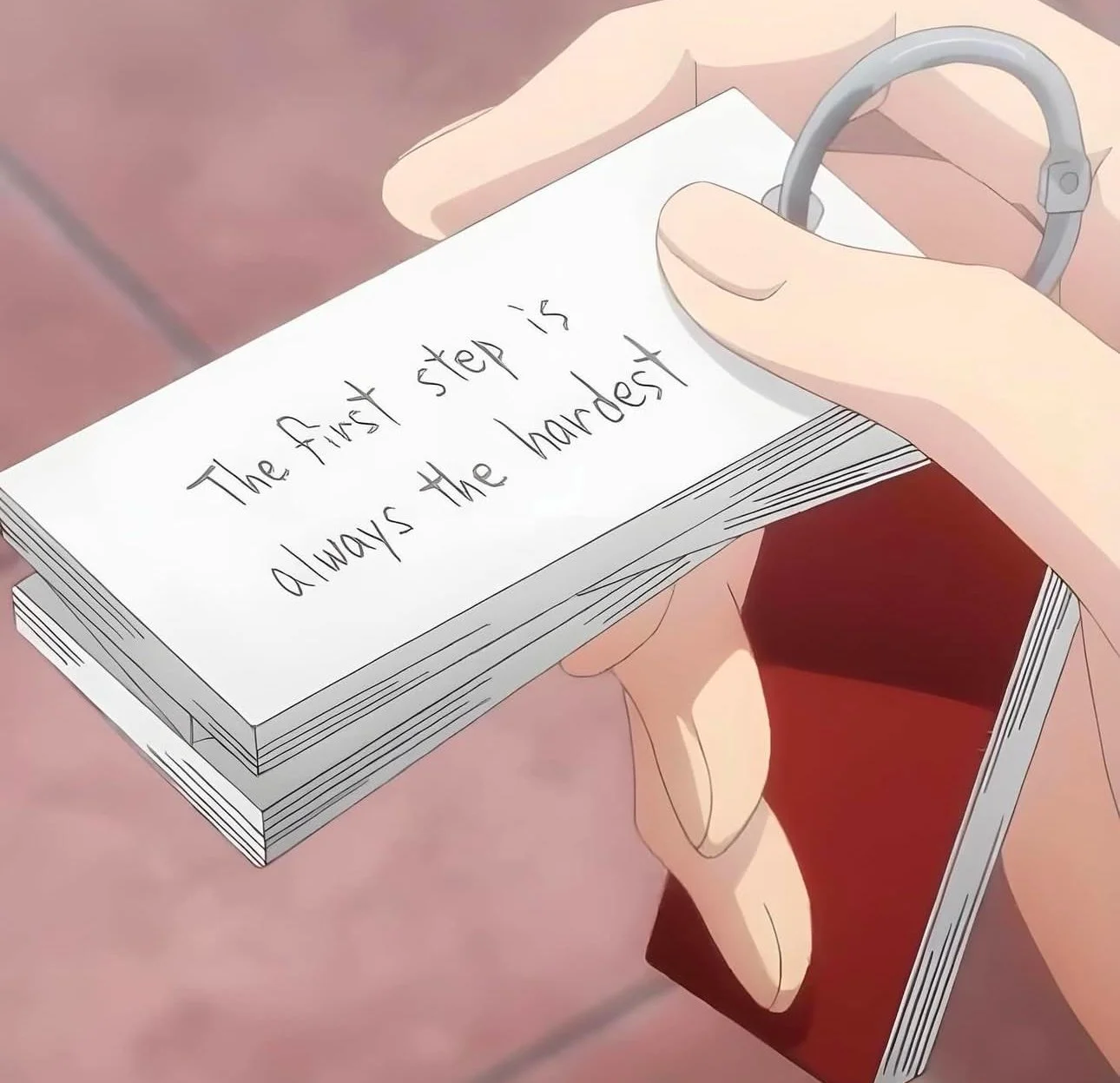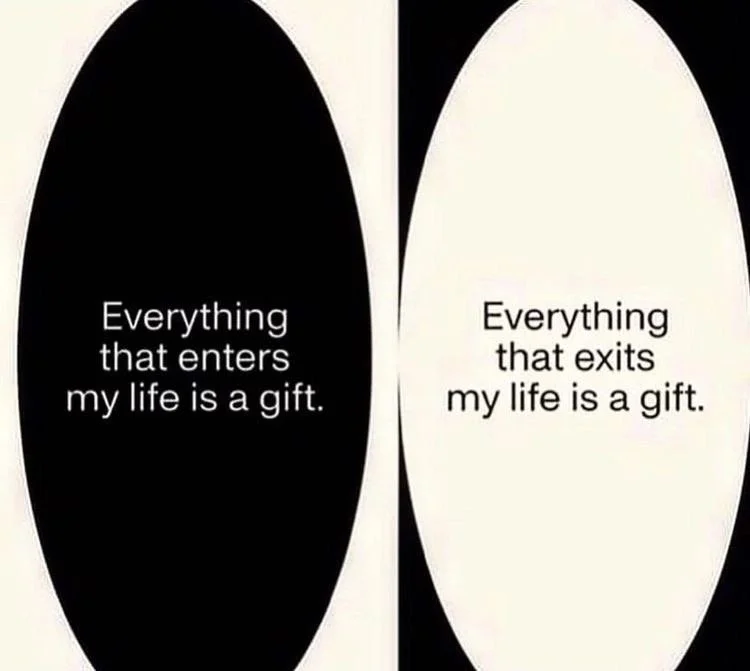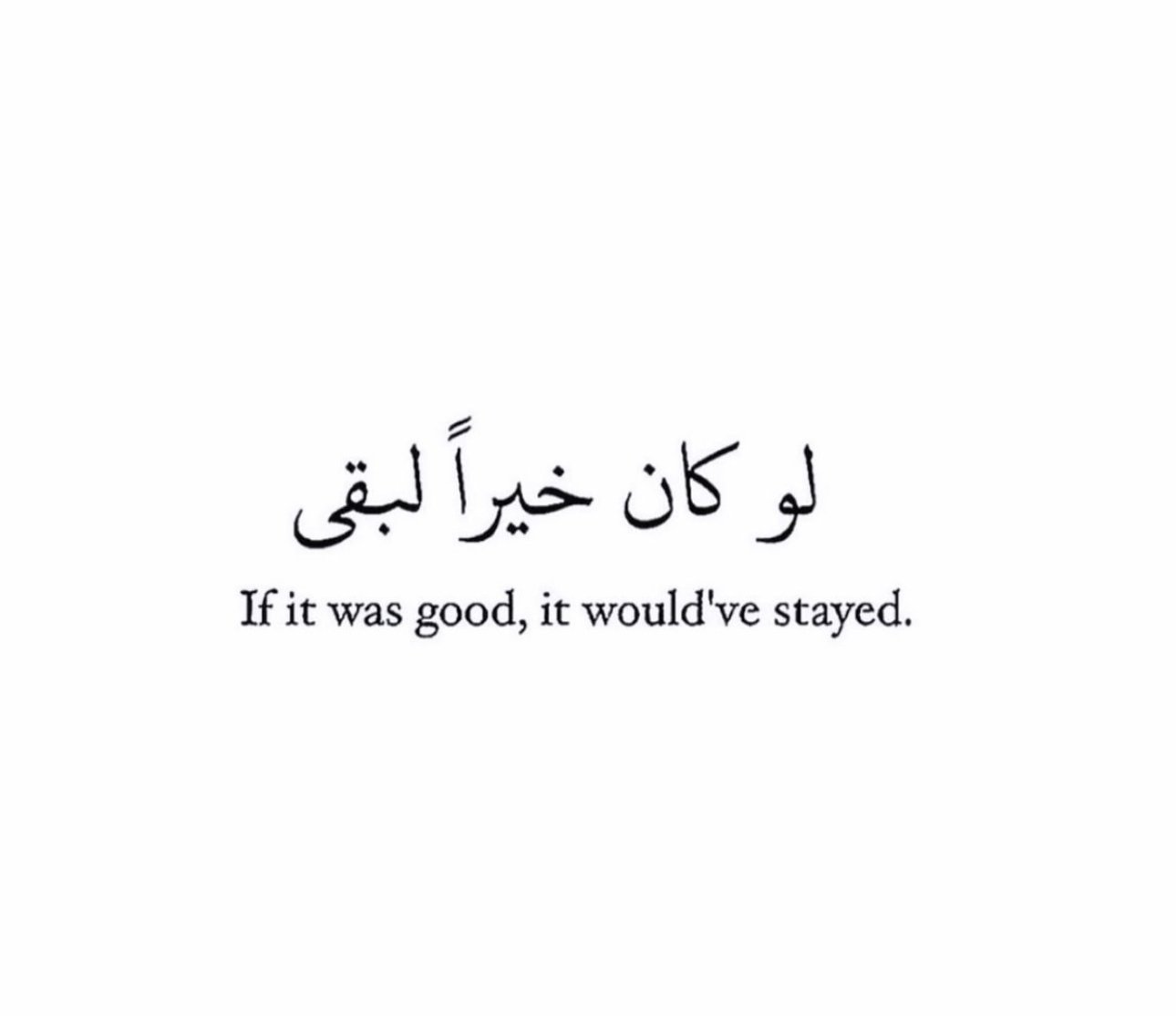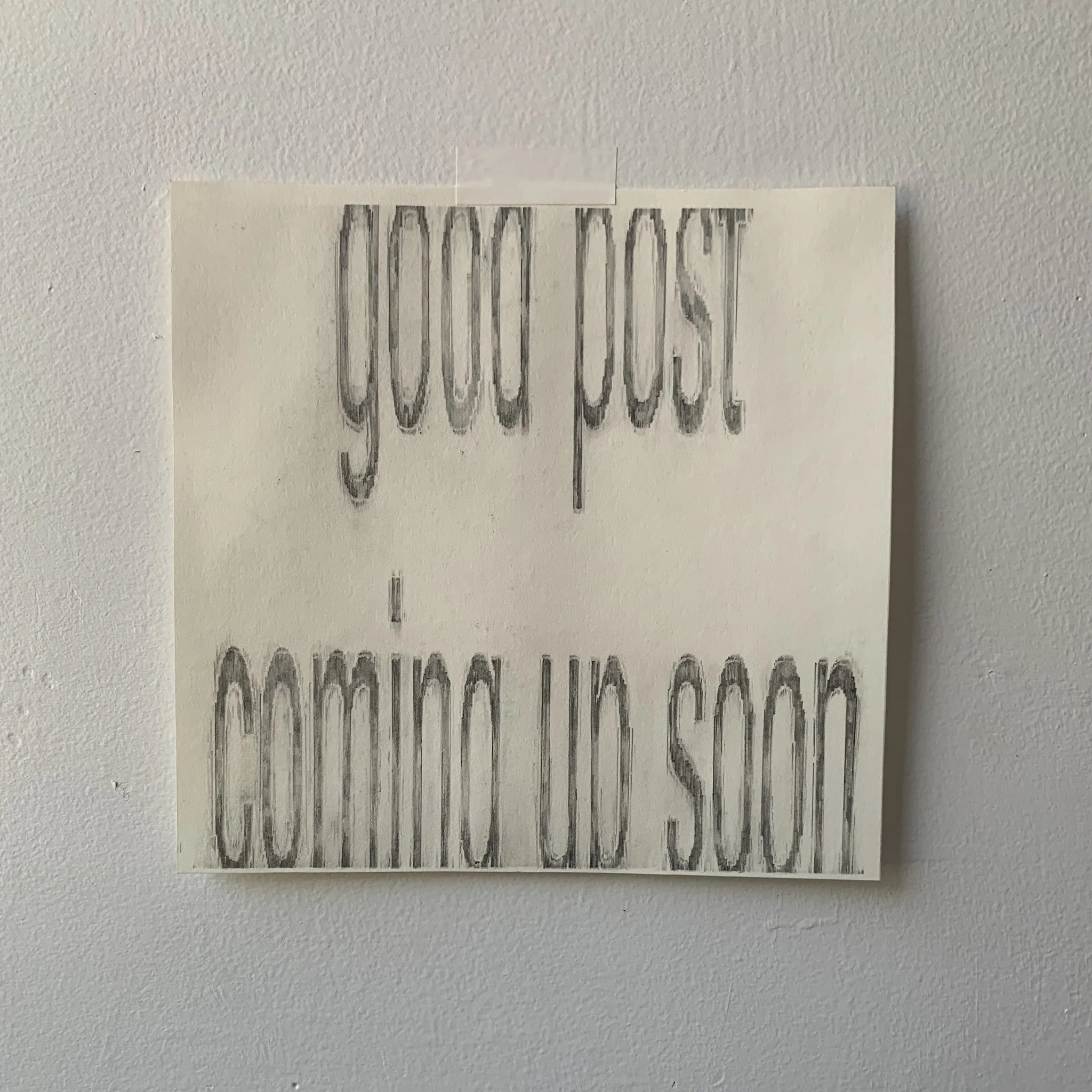Reposant sur le respect de la pensée, de son hôte et de son travail, qui constituent la seule constante égalitaire pour tous les esprits. Une lutte contre l'autolyse et ses conséquences. Prouver que seul l’esprit peut créer des œuvres capables de coaliser et de soigner ses propres méfaits.
Le respect est ici fondamental : il s’agit d’honorer la pensée, non pas comme une simple production mentale, mais comme une entité vivante, parfois fragile, parfois puissante. L'hôte — celui ou celle qui pense — doit se reconnaître dans sa valeur, malgré ses doutes. Le travail — cette mise en forme concrète de la pensée — devient alors le prolongement de cette estime.
L’autolyse, ou la dévalorisation de soi par soi-même, est un mal invisible. L’acte de créer, dans ce contexte, devient une forme d’opposition, une reconstruction volontaire. L’art devient thérapeutique non pas parce qu’il évacue la souffrance, mais parce qu’il la rend partageable, traduisible. Rassembler autour d’un même silence guérisseur.
La recherche débute à l'enfance ; celle-ci doit engendrer la contemplation.
Il faut laisser l'enfant prendre son temps. Admirer ce qui l'entoure et le laisser développer une familiarité. Il en développera des questions en abondance, parfois répétitives, qui devront trouver réponse dans ses racines familiales et/ou dans son environnement local.
La contemplation est un acte flâneur dans un monde pressé. L’enfant, livré à sa lenteur naturelle, entre en relation intime avec les choses. Les fixations enfantines — répéter une même question vingt fois — sont essentielles. Cette lente gestation produit des racines intellectuelles profondes.
Le rôle des parents, des aînés, des éducateurs n’est pas de corriger cette énergie, mais de la canaliser et de l’accompagner. Il ne s’agit pas seulement de nourrir ou d’abriter, mais d’offrir une architecture symbolique — une mythologie, une mémoire locale, des gestes simples, des histoires vécues — sur laquelle l’enfant pourra accrocher ses premières compréhensions.
Un enfant privé de cela grandit, certes, mais dans le sable. Et un esprit sans fondation ne peut soutenir de création durable.
« Tout le monde n’est que la somme de son passé et de celui de ses ascendants. »
Il ne reste qu'à chercher ce qu'il nous faut combler dans des cultures différentes et/ou complémentaires. Un alliage de croyances, cherchant à se rapprocher au maximum d'une nouvelle idéologie plus en adéquation avec son temps, sans dénaturer les croyances plus anciennes.
Nous ne sommes jamais vierges. Chaque pensée que nous émettons est teintée d’un héritage. Mais l’acte de création implique une responsabilité : celle de revisiter cet héritage, d’y chercher les lacunes et les angles morts.
Aller puiser dans d’autres cultures — non pour les copier, mais pour y découvrir des clés, des miroirs, des échos — est une manière de combler ces vides. Le but n’est pas la fusion sans discernement, mais l’alliage, le croisement intelligent.
Une nouvelle idéologie, si elle émerge, ne doit pas écraser l’ancienne, mais la prolonger, la relier à son époque, l’actualiser. Ainsi, on ne crée pas une rupture, mais une évolution.
Chaque ascendant doit être capable de répondre aux nécessités primaires de l'enfant.
Le luxe de la recherche ne doit être accessible qu’à un stade aguerri.
Ce stade se manifeste par l'envie de découvrir, par la douleur de la méconnaissance ou par le choc prématuré, pour certaines personnes.
C'est ce point de non-retour dont traite le ???. Ce remède toxique pousse à découvrir de nouveaux horizons, dans l'espoir de finir par les digérer. Et, grâce à cela, atteindre un statut de concorde.
Il y a une différence entre chercher par curiosité et chercher par nécessité. L’aguerrissement survient lorsque l’individu n’a plus le choix : il doit comprendre ou sombrer.
Cette quête s’apparente alors à une fièvre. Certains y entrent par choc — un deuil, une injustice, un effondrement personnel — d’autres par passion pure ou besoin de sens.
Le ??? intervient comme une réponse à ce moment : il n’est ni doux ni rassurant. Il bouscule, confronte, déstructure. Il peut s’apparenter à un remède brûlant.
Et pourtant, c’est dans cette digestion lente que se forge la concorde : non pas une paix naïve, mais une paix lucide, bâtie sur des fractures consolidées. Ce qui est guéri n’a pas vocation à être rouvert.
C'est ce principe que j'appelle ???.
Un état d'esprit qui ratisse toutes les étapes de la création, une icône dont la définition est la recherche, un outil dont l’utilité est de créer.
Puisqu'il faut apprendre, j'ai besoin du ???.
Puisqu'il faut créer, j'ai besoin du ???.
Puisqu'il faut vivre, j'ai besoin du ???.
Le ??? n’est pas une méthode, mais une respiration. Il ne s’impose pas, il s’intègre. Il accompagne les gestes les plus discrets comme les plus audacieux.
l’ordre (prélude à l’apprentissage)
Pour développer cette conscience créative, différentes étapes se présentent. Et avant d'être capable — et surtout d’avoir l’arrogance — d'apprendre, il faut s'organiser.
« Qui peut soutenir l'étude d'un cas dans un système perturbé ? »
S'organiser permet l'optimisation de l'apprentissage. Aucune réponse n'est universelle quant à l'état physique et psychique de chacun. Il faudra donc des séances d'introspection, ainsi que de l'ardeur, pour cocher toutes les cases.
Pour chaque étape, la bataille est propre à chacun.
Avant même de lancer une idée, il faut faire de la place. Le désordre intérieur ou extérieur empêche l'émergence du nouveau. Il ne s'agit pas ici d'une discipline rigide ou militaire, mais d’un respect du terrain.
L’organisation devient une forme de tendresse envers soi : créer les conditions optimales pour accueillir l’inattendu.
C’est un travail silencieux, qui demande de se confronter à ses résistances. Chaque être humain doit trouver son propre équilibre entre structure et fluidité. L’introspection est donc la clé.
Comment organiser son esprit si celui-ci se développe dans un environnement chaotique ?
Il faut donc commencer par l'espace : ce que l'on perçoit, ce qui est palpable et/ou physique. À commencer par son environnement.
Nous ne parlons pas seulement de ranger sa demeure ou ses fichiers, mais bien d’un tri de ce qui vous éloigne de l'essentiel. Tout doit y passer, y compris les lieux ou zones considérés comme « sans importance », bien que ce ne soit jamais le cas.
Mais aussi les personnes, si cela s’y prête.
Il est nécessaire de rappeler qu'organiser ne veut pas nécessairement dire supprimer. Une relation désordonnée n’a pas toujours à être effacée ; elle doit parfois simplement être repositionnée.
Puis l'ordre se manifeste par le temps. Je ne ferai pas l'affront de souligner que se laisser dissiper nuit à l'apprentissage. Il est cependant nécessaire de stimuler un déroulement clair, laissant place à la coordination mais surtout à la liberté — car l'ordre est synonyme de satisfaction, non de contrainte.
Savoir organiser son temps est primordial, mais il est encore plus important d’apprendre à ne rien faire. Le temps est notre plus grande ressource, et pourtant la plus maltraitée.
Être actif ne signifie pas être productif. L’ordre temporel doit être une respiration, pas une pression.
Cadrer ses journées, oui, mais sans étouffer les silences. Le vide est souvent un terrain en attente d’une idée fertile.
« Si l'activité est primordiale, l'ennui, lui, est décisif. »
Comprendre, c’est déstructurer.
Pour comprendre, il faut détruire — pour soi comme pour l’œuvre.
Pour enfin entamer l'organisation de la pensée, critère le plus important pour soutenir l'apprentissage.
Il s’agit de développer une mentalité propre et claire afin d’accueillir, dans les meilleures conditions, les nouvelles pensées et idées susceptibles de nous soigner.
Certains incarnent ce principe par la religion : un ordre global dicté par des principes laissant transparaître, de manière sous-jacente, les points évoqués précédemment.
D’autres ont soif de preuves et nécessitent l'apprentissage par la psychologie et la science.
Peu importe le chemin, aussi louable soit-il : tous cherchent la raison.
Une fois l'ordre établi, le processus d'apprentissage commence. Chaque recherche, chaque entrevue, chaque point d'intérêt peut produire des bienfaits — même lorsque ceux-ci semblent être des inconvénients.
C'est là que se façonne l'apprentissage.
l’ossature
La création n'est innée pour personne. Elle n'est que travail ardu et recul sur ce travail.
Si apprendre de ses erreurs est une devise universelle, en art, cela doit s’élever au rang de mantra.
L'ego doit être mis à distance, car la comparaison n’a aucun sens. Le jugement non plus.
À la place, il faut pratiquer la réévaluation cognitive : se reposer les bonnes questions. Réétudier ses propres pensées pour les déconstruire ou les stimuler, sans porter offense au bagage initial — rappelons qu’il n’est que la somme de son passé et de celui de ses ascendants.
Cette réévaluation permet d’emprunter un chemin plus apte à la création. Chaque remise en question renforce le contenu. Le cycle — j’y reviendrai plus tard.
Une fois le recul pris, les questions posées et les réponses trouvées, des thématiques émergent. Des points d’ancrage, piliers de votre développement.
Une fois organisé et apte à vous questionner vous-même, votre thématique principale doit apparaître avec une clarté sans équivoque.
la consommation (se nourrir pour mieux produire)
La consommation est sans doute le stade le plus important de toute la démarche. C’est ici que se décide votre statut de créateur. La discipline y est primordiale.
Tout créateur est d’abord un lecteur, un spectateur, un auditeur. Avant de produire, il faut ingérer — mais consciemment.
Consommer n’est pas accumuler : c’est dialoguer, décoder, comprendre.
La discipline réside autant dans ce que l’on absorbe que dans ce que l’on rejette.
Tout initiateur de projet doit se nourrir de créations existantes dans son domaine — et au-delà.
Créer sans maîtriser les codes d’un médium mène à l’échec, non en termes de succès, mais de cohérence.
Explorer ce qui a été fait permet de se situer. Il ne s’agit pas de se comparer, mais de comprendre.
Une même thématique peut être abordée de mille manières. Étudier les œuvres existantes révèle vos écarts, vos singularités.
Une œuvre parle — encore faut-il savoir l’écouter.
Il faut parfois y revenir, laisser résonner, accepter que tout ne soit pas immédiatement compréhensible.
L’information peut être une tension, une couleur, un silence.
Vous n’inventerez rien, mais vous pourrez montrer votre réalité.
Votre vision n’est pas nécessaire à tous, mais elle peut être décisive pour ceux qui la reconnaîtront.
le cycle
Un cycle commence par une simplicité acquise. Puis survient la complexité, souvent déclenchée par un choc.
S’ensuit une accumulation — d’objectifs, d’expériences, de désirs — jusqu’au surdosage.
Enfin vient le retour à la simplicité : une simplicité consciente, choisie, focalisée autour d’un objectif unique.
Le cycle reste le même.
Seul le rythme évolue..